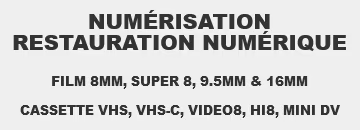- Livraison sécurisée dans toute la France
- Paiement sécurisé par CB & Virement bancaire
- Siège social et laboratoire en Ile de France
- Qualité garantie
Nikon F4
Il ne faudra pas faire concourir le Nikon F4 pour le titre d’appareil « européen » de l’année : il est résolument hors concours, catégorie poids trop lourd pour être comparable à quoi que ce soit. On le voit mal exposé à la critique de journalistes estimables, certes, mais qui s’illustrent peu derrière un viseur, et qui vont lui trouver pas assez de ceci, trop de cela par rapport à des équipements d’amateur, estimables, certes, mais pas faits pour bosser.

Par Chenz
Habituellement, des appareils de cette catégorie, rares heureusement, je me fais une obligation de faire un travail d’un bon millier de photos avec, avant d’écrire la première virgule. Le lecteur m’excusera : outre le fait que les clients se raréfient et commencent à me trouver trop vieux pour être encore créatif, un accident sérieux survenu cet été me cloue sur une chaise roulante pour un certain temps, comme disent les toubibs qui n’aiment pas trop se mouiller, mais m’assurent avec un sourire dubitatif que ce n’est que provisoire. Peut-on faire un reportage d’un millier de photos en fauteuil roulant dans un hôpital? Peut-être pas mille, mais j’ai fait un effort; je comprends beaucoup mieux le travail d’un Gilles Segal depuis que je suis dans son cas. J’aurais été autorisé exceptionnellement à trouver le F4 plutôt lourd: j’apprécie son inertie qui stabilise bien les temps de pose longs, une tenue en main déjà excellente, encore meilleure avec l’alimentation optionnelle à six piles. Je n’ai pas été en mesure d’apprécier pleinement l’étanchéité des passages de commandes rotatives (par joints toriques), car nonobstant tout ce qui a pu être écrit sur la vétusté des lieux, il pleut rarement dans les hôpitaux, et l’on y prend moins de champagne dans la figure que lors des arrivées de Grands Prix (c’est vraiment une manie idiote pour le matériel que celle d’arroser gaiement les journalistes lors de la proclamation des résultats). Bref, j’ai fait ce que j’ai pu, dans des conditions de lumière épouvantables où le système Matrix a été mis à rude épreuve, et j’ai pu bénéficier aussi des remarques de nombre de confrères photographes venus me rendre visite, ce qui fut bon pour le moral et mauvais pour les triglycérides. Que l’on me pardonne, mais ce qui suivra est réellement une étude sérieuse.
La motorisation et les alimentations
J’ai touché un mot de deux types d’alimentations, commençons donc par ce chapitre, puisque tout dans le F4 est sinon nouveauté absolue, tout au moins innovation dans le monde très fermé des appareils professionnels. Les Nikon F et Nikon F2 pouvaient recevoir des moteurs : dans le cas du F, l’alimentation à ses débuts était fournie par un étui de six piles au format C, relié par un câble au moteur, avec déclenchement depuis l’étui, ou par une poignée intermédiaire ; par la suite, une alimentation un peu bricolée put être fixée sous l’appareil. Le F2 conservait encore le principe de l’alimentation bloc distinct du moteur, mais déjà avec une poignée plus sérieuse intégrée. Le Nikon F3 conserve le principe du moteur séparé du boîtier, mais avec alimentation intégrée. Enfin, le F4 reprend le moteur intégré, devenu universel sur tous les appareils d’amateur (en moins de cinq ans !), avec une alimentation intégrée de quatre piles AA logées dans la poignée, elle aussi partie intégrante de l’appareil ; suffisante pour la plupart des cas de figure, cette alimentation peut être portée à six piles AA par rajout d’un accessoire optionnel, trois étant logées dans la poignée, et trois dans le socle ; le changement des piles s’effectue dans tous les cas rapidement et sans dépose d’accessoires, par démontage du bloc piles au moyen d’une clé papillon située sous la poignée. Sur celle-ci, et tombant naturellement sous l’index, se trouve Je déclencheur électrique, entouré d’une couronne de sélection des options moteur : verrouillé, vue par vue, continu lent (2 im/s), continu rapide (5,7 im/s avec six piles), continu silencieux (une première : le réarmement s’effectue en plusieurs petits coups, à la cadence d’une image/seconde, et ne fait plus ce sifflement caractéristique des appareils à moteur, mais un bruit comparable à celui-d’un réarmement manuel, et enfin commande d’un retardateur qui peut être utile à certaines prises de vues sur microscope plus qu’au portraiturage (improbable) de l’auteur par lui-même, mais qui ne peut être utilisé qu’à des intervalles d’une minute. Cette couronne est protégée contre les manipulations intempestives par un petit bouton de sécurité dont je n’ai pas trouvé la manipulation très commode, mais il faut bien dire que l’accident m’a touché également un peu les mains, donc le toucher n’est plus ce qu’il était.
Cela dit, il est préférable, si l’usage envisagé est plutôt versatile et n’est pas limité à la seule prise de vue d’illustration, de prendre tout de suite l’option six piles, sur laquelle se trouve un second déclencheur pratique en cadrage vertical, et surtout la prise de télécommande standard Nikon. A défaut, signalons que le boîtier est équipé d’une prise pour déclencheur souple au pas conique, un accessoire un peu oublié sur les appareils récents. La surimpression est possible, par un petit levier placé à côté du compteur, qu’il faut réarmer à chaque surimpression. En l’absence d’une contre-griffe, le F4 ne peut pas être considéré comme« pin registered », et n’est donc pas réalisé spécifiquement pour la surimpression de précision. Le rembobinage a été conservé volontairement en deux temps : débrayage du débiteur denté par un levier placé derrière le bouton des vitesses et muni d’une sécurité et, soit rembobinage à main, par la manivelle ad hoc, soit rembobinage électrique par un second levier placé sous la manivelle, également avec sécurité. Dans ce dernier cas, l’amorce est entrée intégralement dans sa cartouche, option la plus courante pour les professionnels, et vivement conseillée pour éviter les méprises, mais une option réalisable en atelier permet dé la garder sortie en rembobinage électrique. Celui-ci est puissant et rapide (une dizaine de secondes). Quatre moteurs « coreless » (le rotor est un cylindre situé entre l’aimant permanent central et les bobinages périphériques) spécialement étudiés assurent toutes les fonctions motorisés de l’appareil : avance, rembobinage, armement de l’obturateur et du miroir, mise au point automatique.
L’obturateur
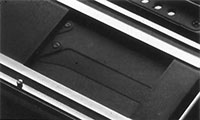
L’une des obligations de cahier des charges du F4 était de pouvoir fonctionner en miroir relevé, ce qui se fait comme sur les F2 et F3, par le même levier entourant le bouton de test de profondeur de champ (uniquement mécanique, ne fonctionne qu’en modes A et M). Cette obligation plus d’autres ont conduit à la conception d’un obturateur original, conçu et réalisé par Nikon, qui comprend deux jeux de quatre lames, un jeu en fibres de carbone, et un jeu en alliage d’aluminium. En fait, il s’agit d’un double obturateur à guillotine, qui fonctionne exactement, mais en translation verticale, comme le double rideau des obturateurs horizontaux des F, F2, F3. Avant l’exposition, les obturateurs A et B sont fermés. Au moment de l’exposition, lorsque le miroir se relève, B s’ouvre, A s’ouvre, B se ferme et suit A pour former une fente aux vitesses supérieures à celle de synchronisation (x= 1:250) ; à la fin de l’exposition, A est ouvert et B fermé, le réarmement viendra mettre les deux obturateurs en position fermée et rabaissera le miroir.
Pour éviter les vibrations inhérentes à tout obturateur aux vitesses moyennes (1/250 à 1/15), un amortisseur en alliage de tungstène est entraîné en sens contraire du mouvement du rideau, créant un champ de vibrations qui vient neutraliser celui propre de l’obturateur. D’autres types d’amortissements jouent sur les vibrations du miroir, mais la seule vraie sécurité pour des clichés très spéciaux est de travailler en miroir relevé.
Bien entendu, le F4 bénéficie des travaux qui ont conduit au F-801, et son obturateur permet une vitesse de 1/8000. A l’autre bout de l’échelle, on s’est limité à 4 secondes dans les modes S et manuel, les vitesses plus lentes étant servies par une pose B classique, et une pose T qui ne peut être interrompue qu’en passant le bouton des vitesses sur une autre position. Par contre, les modes P, PH et A autorisent des temps d’exposition en automatique jusqu’à 30 secondes. La commande des vitesses en manuel ou en mode S (priorité vitesse) s’effectue par un gros bouton rotatif qui ne déroutera guère les habitués des modèles précédents, et sur lequel figurent également le 1/250, marqué en rouge, et la vitesse X, également 1/250, mais verrouillée pour éviter les gags. Le bouton de déverrouillage est placé au sommet du bouton des vitesses, celui-ci pouvant être tourné toujours dans le même sens.
L’utilisateur qui voudra voir fonctionner son obturateur, dos ouvert, aura une surprise : une sécurité interdit cette pratique, génératrice de saloperies dans le mécanisme. Mais on peut la forcer : il suffit d’enfoncer avec l’ongle le minuscule poussoir placé dans la rainure du boîtier où s’intègre le dos, sous le bouton de rembobinage ; un poussoir symétrique, sous le compteur, remet celui-ci à zéro à l’ouverture du dos.
Le compteur lui-même est classique, mécanique et ne fonctionne que lorsqu’un film est chargé : le chargement du F4 est du type tout automatique, sans option possible, la fiabilité de ce type de chargement ayant été reconnue. C’est dans la bobine réceptrice du film que se trouve le moteur d’entraînement, le débiteur denté ne faisant que compter les perforations – il retrouve un rôle d’entraînement avec le dos 250 vues. A noter qu’à la demande générale des photographes, qui ont été très consultés pour la conception de l’appareil, le compteur est répété dans le viseur, comme on le verra plus loin.
On pourra gloser sur le principe du chargement automatique, qui en fera tiquer plus d’un ; il est vrai que celui-ci peut grogner en présence de films pas trop frais, dont l’amorce présente un curl trop important, ou devant des films bobinés par l’utilisateur, qui devra découper une amorce à peu près correcte : à ce propos, je donne une idée aux fabricants d’accessoires qui pourraient proposer un cisaille effectuant proprement cette découpe, nombre d’opérateurs utilisant du film en bandes, reconditionné, pour des raisons d’économie, ou pour des usages spéciaux (duplicating, Kodalith, positive). Ma triste situation ne m’a pas permis de vérifier la qualité de l’implantation du film après déchargement et rechargement, mais cette qualité doit être bonne si l’on prend bien la précaution de toujours placer l’extrémité de l’amorce sur la marque rouge en bout de boîtier.
La mise au point automatique et les objectifs
La très grande force du F4 tient beaucoup dans la possibilité d’utiliser toute la gamme d’objectifs de la marque depuis sa création, avec bien entendu un service plus ou moins étendu suivant le type d’objectifs. Si la baïonnette n’a pas changé depuis 1958, quelques grandes modifications sont apparues au fil des années et des progrès techniques : la «fourchette» liée au diaphragme a disparu, remplacée par la monture « AI » dont certains vieux objectifs ont pu être équipés, devenant alors des « transformés AI »; les obligations liées aux programmes ont fait modifier cette dernière en AI-S (la valeur la plus élevée du diaphragme est toujours marquée en orange), les objectifs à mise au point automatique AF sont apparus depuis le F-501, et l’on peut ajouter à la liste la série E économique et quelques objectifs pour usages spéciaux.
Mettons de côté le cas des objectifs à fourchette non transformés AI, qui se font rares et font plutôt la joie des collectionneurs : on peut les utiliser, on aura même la mise au point assistée s’ils ouvrent au moins à 5,6, mais pour la cellule, il faudra recourir à la mesure à ouverture réelle, possible avec le F4 en modes pondéré central ou spot. Les mêmes objectifs modifiés AI ouvrent l’utilisation de la cellule dans les mêmes modes, la pose manuelle et l’automatisme A. Tous les autres AI accèdent à la mesure matricielle, au même automatisme, et à la mise au point automatique avec l’adaptateur TC-16A s’ils ouvrent au moins à 2,8. Seuls les AF offrent toutes les possibilités.
Le système de mise au point automatique reprend en gros les caractéristiques de celui du F-801, avec le groupe opto-électronique AM-200, à deux rangées de 110 CCD orientés obliquement à 45° , ce qui permet une bonne détection des lignes tant horizontales que verticales. On peut noter une première différence dans la présence d’un filtre infrarouge escamotable coupant ces rayonnements dans la prise de vues en lumière ambiante pour éviter une mise au point sur un plan optique incorrect, et se remettant en place lorsque l’on utilise les émetteurs infrarouge des flashes électroniques. Cette mise en place est automatique. Le détail a été poussé au point de prévoir un dispositif d’élimination des poussières sur les filtres. Le logiciel d’utilisation est plus avancé que celui du 801, et applique notamment une « prédiction de position » sur les sujets mobiles, comparable à celle du Dynax 7000i : l’appareil effectue, en position mise au point auto continue, une série de mesures successives sur les sujets en mouvement, et par comparaison entre ces mesures, calcule la vitesse du mobile, et sa position probable au moment de l’ouverture de l’obturateur ; ce calcul permet la recherche de discontinuités dans les mesures de déterminer un changement de direction du mobile, et d’annihiler dans ce cas la prédiction de position. Dans tous les cas, pour bénéficier de celle-ci, il faut donc se mettre dans les modes « mise au point auto continue » et « armement lent (CL)», il faut en effet laisser au calculateur le temps d’évaluer la vitesse du sujet entre deux vues. Dans ce mode de mise au point continue, il est possible de bloquer temporairement l’autofocus par appui sur un bouton placé sous celui de contrôle de profondeur de champ, et qui tombe assez bien sous le médius ; un commutateur entourant ce bouton permet de lier cette fonction au blocage de la mesure d’exposition, effectué par ailleurs ailleurs séparément par un autre bouton placé sous le premier. Ces commandes sont pratiques lorsque l’on désire effectuer un décadrage du sujet principal, mais il est évident que la plupart des professionnels préfèreront dans ce cas revenir à la mise au point manuelle, l’automatique se prêtant moins au travail de composition qu’à la photo de sport ou d’action. Le senseur fonctionne en lumière ambiante, comme celui du 801, jusqu’à IL -1 ; en-dessous de cet éclairement, il convient d’utiliser un pré-éclair infrarouge, émis par les flashes SB-20, 22, 23 ou 24. Évidemment, seuls les objectifs AF ou les objectifs AI montés sur le TC-16A bénéficient de la mise au point automatique, mais tous, en mise au point manuelle, et pour peu qu’ils ouvrent au moins à 5,6, bénéficient de la mise au point assistée, traduite dans le viseur par un voyant LED vert, deux flèches rouges indiquant dans quel sens tourner la bague de mise au point.
La commande du diaphragme reste traditionnelle sur les objectifs AF, ce qui évite une certaine désorientation lorsque l’on passe de ce type d’objectifs aux anciens ; il convient lorsque l’on opère dans les modes programme ou priorité vitesse de placer la bague de diaphragme sur la valeur la plus fermée ; les objectifs AF possèdent d’ailleurs un verrou pour bloquer la bague dans cette position ; le fait de la laisser sur une autre valeur n’inhibe pas ces modes, mais limite les options possibles de l’appareil entre l’ouverture maximale et l’ouverture affichée, et se traduit par l’affichage de «FEE» dans le viseur à la place de la valeur du diaphragme. La commande interne reste également traditionnelle avec dans les modes précités la fameuse « cybernation » : l’appareil calcule un diaphragme en fonction de la vitesse affichée, ferme celui-ci, et affine la valeur de la vitesse en fonction de l’ouverture réelle obtenue.
La cellule et le calculateur d’exposition
On touche là l’un des points essentiels du F4, équipé de trois modes de mesure : un mode spot, un mode dit « pondéré central » qui remplace la « mesure centrée » du 801 et s’apparente davantage au type de mesure du F3, mais largement amélioré, et enfin la fameuse mesure « Matrix », inaugurée avec le Nikon FA, affinée avec le 401 et surtout le 801, et encore réaffinée ici. Attention : ce type de mesure ne fonctionne pas avec tous les objectifs, et en particulier pas avec les objectifs à fourchette ni les modifiés AI ; par ailleurs, on ne la trouve qu’avec le viseur standard, mais nous reviendrons sur ce point. On connaît le principe: l’image est divisée en cinq zones, effectuant une mesure centrale, et quatre dans les quatre coins. La mesure est effectuée par deux groupes opto-électroniques au silicium, l’un lisant les zones 1, 2 et 4, l’autre les zones 1, 3 et 5. Les deux groupes lisent donc tous deux la zone centrale, mesure qui est utilisée aussi dans le mode « pondéré central ». Les mesures analogiques sont numérisées, et traitées par un calculateur. En fonction des « mots » informatiques obtenus, le calculateur analyse la scène, et détermine s’il convient de favoriser les hautes lumières, les grandes ombres, ou une moyenne, après réjection des valeurs extrêmes. En fait, il travaille comme le ferait un photographe expérimenté, le principe étant d’effectuer une reconnaissance du sujet, et de pondérer l’exposition comme l’auraient fait tout un staff de photographes consultés pour la rédaction du fichier de comparaison. Plus qu’un mode de calcul compliqué, le système Matrix apporte à l’opérateur l’expérience de tout un syndicat de photographes. Tout cela est bien beau, mais ce dispositif appliqué au 801 fonctionnait fort bien en prise de vue horizontale, cadrage pour lequel sont organisés cellules et algorithmes, mais qu’en est-il en cadrage vertical dans un sens ou dans l’autre, et ce grâce à quatre interrupteurs au mercure logés dans le viseur.
Le mode pondéré central affecte 60% de l’exposition au centre de l’image, à l’intérieur d’un cercle de 12mm de diamètre et 40% au reste ; le mode spot base toute la mesure dans un cercle de 5mm de diamètre. Cette mesure est effectuée dans le détecteur de mise au point auto.
Le mode spot est applicable à tous les types de viseur, le mode pondéré central aux viseurs DP-20 (standard) et DA-20 (sportif), le mode Matrix au seul DP-20. La commutation d’un mode à l’autre s’effectue donc sur le viseur même. L’affichage de la rapidité du film s’effectue comme sur le 801, soit par code DX (les palpeurs ne prennent en compte que cette rapidité), soit manuellement, de 6 à 6400 ISO. Il existe également un correcteur volontaire d’exposition, qui prend ici une place et une importance inhabituelles sur un appareil professionnel : il semblerait que ce soit à la demande de nombreux utilisateurs, surtout dans le domaine de l’illustration. La commande correspondante est placée à droite du bouton des vitesses, et offre une dérive de + /- deux diaphragmes, de tiers en tiers, avec un verrou de sécurité. Elle est coaxiale à la commande de sélection des modes d’exposition : programme P, programme PH privilégiant les vitesses, S pour priorité à la vitesse, A pour priorité à l’ouverture, M pour manuel.
La visée et les différents viseurs
Comme sur les appareils précédents de la série, les viseurs et verres de visée sont interchangeables (cinq viseurs et treize verres de visée, tous spécifiques au F4 ), et le F4 est actuellement le seul appareil récent à offrir cette possibilité.
Le viseur de base est le DP-20, de type pentaprisme avec un point de sortie oculaire à 22mm (déjà introduit sur le F3-HP et sur le 801), avec une couverture effective de 100% de l’image. Il se dépose en libérant le verrou situé à sa gauche, et en le faisant coulisser sur un rail, ce qui lui assure un meilleur positionnement que la technique utilisée sur les modèles précédents. Son point d’oculaire très soigné permet son utilisation au porteurs de lunettes avec une pleine vision de l’ensemble du viseur, informations comprises, mais en plus il dispose d’une correction dioptrique réglable par un bouton situé sur la droite du capot, à coté du commutateur de types de mesure, avec une correction de -3 à +1 dioptries, ce qui n’empêche pas la pose de lentille fixes venant en complément. L’oculaire peut encore recevoir, à travers l’intermédiaire DK-7, les loupes de visée DG-2 (droite) et DR-3 ( à angle droit). En l’absence d’accessoires, l’oculaire est garni d’une pièce en caoutchouc, utile pour la protection des lunettes. Un opercule amovible permet de boucher l’oculaire pour les poses effectuées au retardateur. On peut affirmer sans hésiter qu’il s’agit-là du meilleur viseur du marché, et de très loin.
La pose et la dépose des verres de visée s’effectue en quelques secondes, sans outil, après dépose du viseur ; étant donné que les verres de visée n’ont pas tous la même transmission photométrique, un réglage de compensation est prévu dans le viseur, ajustable au moyen d’un tournevis ; on admettra que ce réglage (- 2 à + 0,5 EV, affiché sur le côté droit du viseur) ne s’effectue pas souvent, les opérateurs s’en tenant habituellement toujours au même verre de visée pour leur travail habituel. Le plus courant, livré en standard, est le type B (références de l’autofocus et anneau clair sur fond Fresnel) ; on recommandera, pour des applications de haute définition comme la duplication les verres de visée C et M.
Nouveauté sur les appareils professionnels Nikon : l’apparition d’une griffe « hotshoe » montée directement sur le viseur (ainsi que sur le viseur sportif DA-20), et qui assure le couplage TTL avec tous les flashes dédiés Nikon depuis le SB-15. On sait ce que je pense du flash fixé sur l’appareil, excusable au mieux pour les reporters de presse : il suffit d’utiliser un câble allonge spirale pour que le flash puisse être tenu à bout de bras sans perdre ses automatismes.
Deux rangées d’afficheurs LCD et LED, au-dessus et en-dessous de la fenêtre horizontale, visualisent toutes les informations de l’appareil : en haut à gauche, la valeur de la correction volontaire d’exposition et le compte de vues ; au centre, une lecture optique de la valeur de diaphragme affichée sur l’objectif ; à droite, le voyant vert et les flèches rouges de l’autofocus, un signal indiquant la mise en place d’une correction volontaire (tout cela reste surprenant sur un appareil pro) et l’indicateur de ready-flash ; en bas, en afficheurs LCD, l’indicateur de mode de mesure, la vitesse, et suivant les modes d’exposition, le diaphragme (en programme ou mode S), et l’indicateur du mode sélectionné ; en mode manuel, ces deux derniers affichages sont remplacés par une échelle et un spot mobile donnant l’écart entre la pose affichée par l’opérateur et celle proposée par la cellule. Très complets, ces affichages peuvent être éclairés par des diodes vertes lorsque l’opérateur se trouve dans un endroit sombre, ce qui est le cas général en spectacle : un interrupteur placé sous le bouton des vitesses rend l’éclairage actif lorsque l’on effectue un pré-déclenchement, ce qui est franchement plus intelligent que le ridicule petit poussoir présent sur le F3.
Trois autres viseurs reprennent des techniques déjà connues sur F2 et F3 : le viseur de poitrine OW-20, la loupe de visée 6X DW-21, corrigeable de -5 à +3 dioptries, et surtout le fameux viseur sportif DA-20, indispensable lorsque pour une raison ou une autre (par exemple lors de l’emploi de l’appareil en caisson sous-marin), il est impossible d’approcher l’œil de l’oculaire. Et on peut y rajouter une pièce unique en son genre, encore qu’il y ait déjà eu quelques prototypes tentés par Nikon dans les temps anciens : le Remote Video Viewfinder, qui se monte sur le boîtier exactement comme les précédents, et adresse l’image du verre de visée par l’intermédiaire d’un objectif de 20 mm à un CCD bloc de 2/3″ monochrome avec une résolution de 250 000 pixels en 525 lignes, relié par un câble qui peut faire jusqu’à 100m à l’unité de contrôle (un moniteur NB) et de télécommande. Une prise sur le viseur permet de télécommander l’appareil dans toutes ses fonctions, retardateur excepté, et une unité de cadrage (rotule réglable en panoramique et azimut). Ce matériel sera disponible prochainement, et devrait être utilisé pour la surveillance (avec en complément un caisson de comparaison trame à trame qui effectue automatiquement un déclenchement lorsque le contenu de l’image change), en photo animalière, bref, dans tous les cas où la présence de l’opérateur derrière l’appareil est dangereuse ou non souhaitée.
Le flash
Il a déjà été question des griffes hotshoe, on peut y ajouter une prise de flash standard 3 mm, à monture vissante : là encore, le F4 est pratiquement le seul appareil récent à disposer de cette prise indispensable en usage professionnel. Avec les flashes dedicated SB-15 à SB-24, lorsque l’on est en mode de mesure matricielle, celle-ci va intervenir dans la puissance du flash pour équilibrer celui-ci avec la lumière ambiante (Matrix Balanced Fill-Flash). A noter qu’en mode programme, la vitesse de synchronisation choisie par l’appareil est de 1/60 pour offrir une plus large gamme de réglages possibles du diaphragme. En modes Set manuel, toutes les vitesses sont possibles de 4s à 1/250. A noter que les contacts flash sont protégés par des diodes pour éviter tout souci dû à des polarités impropres ou à des tensions de synchro élevées, comme c’est le cas avec les Balcar.
Le boîtier
Pour loger les 1750 pièces, plus les piles et les quatre moteurs, il fallait un boîtier à la hauteur de la situation. Celui-ci est composé de quatre pièces de fonderie en alliage d’aluminium, traité pour résister à la corrosion. L’ensemble est gainé d’un composite de caoutchouc qui améliore la prise en main et absorbe les chocs. On peut remarquer le côté particulièrement lisse du F4, option qui n’est pas due au seul dessinateur Giugaro, mais voulue pour éviter tout accrochage de commandes dans des manipulations qui peuvent être brutales. Le F4 n’est pas fait pour faire joujou, mais pour travailler : son obturateur est testé pour un minimum de 150000 déclenchements avant révision. On comprendra de ce fait la robustesse de l’ensemble, qui se paye par le poids relativement élevé du boîtier : 1100 g. Le traitement électronique est à la même enseigne, et est protégé contre un environnement caractérisé souvent par des champs électromagnétiques intenses. L’appareil est réputé ne pas être affecté par des températures de -40 à + 70° (faut voir ce que donnent les piles par -40° !), par l’humidité (90% à 40° pendant 20 heures) ou par la sécheresse. Il a été largement testé aux Jeux Olympiques de Séoul ; seule maintenant l’expérience statistique de milliers de photographes pourra confirmer ou infirmer ces spécifications.
Les accessoires
Évidemment, un appareil de ce type, destiné à remplir les missions professionnelles les plus diverses, se doit de disposer d’une gamme d’accessoires étendue. Certains lui sont spécifiques, comme des batteries d’alimentation (l’une d’elle reprend la forme et l’emplacement de l’alimentation six piles) et surtout le dos multi-fonctions 250 vues MF-24, d’autres viennent du 801, comme le dos multi-fonctions MF-23 ou le dos dateur MF-22. Le dos MF-23 et 24 permettent certaines fonctions complémentaires comme le bracket automatique, ou le déclenchement automatique lorsque le sujet passe dans un champ de mise au point réglé manuellement. La plupart, comme les poignées ou les intervallomètres, déclencheurs, radio, etc. viennent directement des collections du F2 et du F3.
Ça paraît trop beau, un appareil sans défauts : moi, réputé critique acide, n’ai-je rien trouvé, mon jugement a-t-il été mis en défaut par une fréquentation trop prolongé du fauteuil à roulettes ? Allons-y pour des bricoles, des histoires de compromis : chaque commande importante, modifiant l’état de l’appareil, est doté d’une sécurité. C’est bien, car ça rassure, mais toutes ces sécurités énervent un peu, et donnent de l’acné au bel objet. D’accord, mais ne pas mettre ces sécurités auraient fait prendre dans de nombreux cas des risques inacceptables : un rembobinage en plein boulot, une correction volontaire/involontaire d’exposition, on ne peut pas jouer avec çà. Et puis, il y a un peu aussi ce côté lisse, bien poli, qui peut amener certaines commandes à être d’une manipulation délicate, comme celle des fonctions moteur; là, je suis influencé par mon toucher qui a pris des claques dans l’accident, et ce côté lisse a justement été voulu pour éviter de s’accrocher dedans. Il y a aussi l’absence de prise de télécommande sur le boîtier standard en quatre piles, qui oblige à s’équiper d’entrée avec le six piles. En face, dans les compliments, on peut rajouter le fait que l’opérateur familiarisé avec le F2 ou le F3 ne sera absolument pas désorienté par un F4 qui reprend la même ergonomie avec des qualités en plus. Bon, je n’ai plus rien d’autre à dire sur le sujet.
A part çà, mon accident, c’est un accident de plongée ; comme il y en a qui disent, ça me pendait au nez. En attendant, le prochain appareil sous-marin faudrait pas qu’il sorte trop vite : je vais le tester comment, moi : en palmes à roulettes ?
- Saga 8mm
99 Boulevard de la Reine
78000 Versailles


- Tél : 01 83 62 83 13
- Horaires d’accueil téléphonique :
9h00-12h30 / 14h-17h30 du lundi au vendredi
10h00 – 12h30 le samedi
Mentions légales – Contact – Crédits photos Pexels – Unsplash – Freepiks -Stockvault – Pixabay
© Saga 8mm 2025
Hébergement OVH